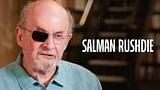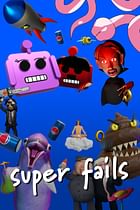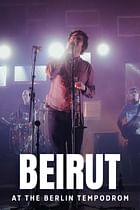ARTE, the European culture TV channel, free and on demand

Taking Sides
The Furtwängler Case
Was famous conductor Wilhelm Furtwängler, for or against the Nazis? Feature film biopic starring Harvey Keitel and Moritz Bleibtreu.
Highlights
Unmissable
NotVisible